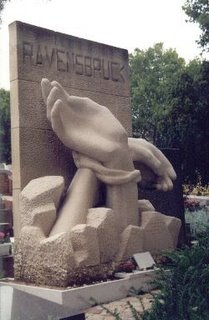Les partis politiques marocains sont nuls. Ce n’est pas une opinion qu’on peut discuter ou nuancer, ce n’est pas un procès en instance, c’est un verdict sans appel que nul, d’ailleurs, ne conteste. Il arrive même que la sentence - les partis sont nuls - soit déclinée en présence de membres du gouvernement, par ailleurs figures de partis vénérables ou méritants (comme dans un colloque organisé récemment à Paris par les étudiants marocains des grandes écoles) sans que les intéressés y trouvent à redire. Comment nier l’évidence ?Pour être devenu un lieu commun de la politique marocaine, l’incapacité déclarée des partis ne cesse de surprendre. Les partis en question ont tout de même une histoire glorieuse qui ne se réduit pas au combat contre le protectorat. Mohammed V a été un grand roi parce qu’il a su rester en phase avec les formations politiques, à l’époque l’Istiqlal et le PDI (Parti démocratique de l’indépendance). Après la libération du royaume en 1955, ce qu’on appelle ici le Mouvement national a continué à jouer un rôle essentiel. L’Istiqlal et l’Union nationale des forces populaires (UNFP, issue d’une scission du premier et qui deviendra en 1975 l’Union socialiste des forces populaires, USFP), pour ne citer que les partis qui ont démontré leur capacité à garder leur autonomie face au Palais, ont tenu leur rang dans la lutte pour la démocratie. Hassan II avait dit un jour à son professeur de mathématiques, Mehdi Ben Barka, qu’il « n’accepterait jamais que la monarchie soit mise en équation ». Il avait pris soin d’interdire dans la première Constitution du royaume (1962) le parti unique et d’instaurer, à sa manière, le multipartisme en encourageant l’organisation politique du pays berbère et en parrainant, la veille de chaque consultation électorale, des « partis Cocotte-Minute ». L’objectif constant était d’empêcher le Mouvement national d’avoir le monopole de la représentation populaire. Mais le même Hassan II n’avait jamais rompu les liens avec les leaders des « vrais » partis, y compris les hommes qui travaillaient à sa perte. Après avoir négocié pied à pied avec la Koutla (Bloc démocratique rassemblant essentiellement Istiqlal, USFP et PPS) une Constitution équilibrée, il avait appelé au pouvoir ceux qu’il avait toujours combattus pour mettre en place le « gouvernement d’alternance », dirigé par le socialiste Abderrahmane Youssoufi.
Comment expliquer, alors, que ces partis, qui n’ont pas démérité de la démocratie et qui ne sont pas étrangers à l’évolution, lente mais réelle, de l’ancien Empire chérifien vers une monarchie constitutionnelle, soient gagnés depuis par un engourdissement pathétique et semblent carrément hors jeu. Ils siègent au gouvernement, certains parmi eux sont d’excellents ministres, mais chacun sait que leurs performances, ils les doivent plus à leur coefficient personnel qu’aux partis qu’ils sont censés représenter. D’ailleurs, lors de la formation du cabinet Driss Jettou, c’est le Palais davantage que leur famille politique supposée qui a suscité leur désignation.
La carence des partis en tant que tels pose problème. Les manifestations, les symptômes de nullité sont patents. Il existe au Maroc un Parlement, avec deux Chambres ; il est issu d’élections régulières ; il compte une majorité plurielle (USFP, Istiqlal, Mouvance populaire, PPS, RNI, etc.) et une opposition (notamment islamiste). Mais les Marocains ne sont guère passionnés par leur Parlement. À vrai dire, rien ne s’y passe qui ressemblerait à une activité parlementaire digne de ce nom : débats, confrontations, motions de censure, enquêtes… Même lorsqu’il s’est agi de la réforme du code de la famille (Moudawana), qui avait enflammé les esprits, le Parlement a brillé par son absence. C’est le Palais qui a diligenté les débats dans le pays ainsi que l’élaboration des compromis nécessaires, et le Parlement s’est contenté d’entériner la nouvelle législation.
La presse des partis offre un autre symptôme. Alors que les journaux connaissent un foisonnement réel avec des résultats de qualité inégale, les titres « historiques » ronronnent et, même lorsqu’ils font peau neuve, ont de la peine à retrouver leur influence perdue. Al-Ahdath Al-Maghribiya, le quotidien dont les ventes ont franchi le seuil des 100 000 exemplaires, est animé par Ahmed Brini qui a fait ses armes dans Al-Ittihad Al Ichtiraki (socialiste) mais a dû s’en éloigner pour créer un vrai journal. As-Sabah, l’autre titre arabe, qui le talonne et même le dépasse, est issu du groupe L’Économiste que dirige Abdelmouneim Dilami, en dehors de toute obédience partisane. Du côté des hebdomadaires, les publications proches des partis ont pratiquement disparu. Parmi les titres francophones, rien de comparable dans l’univers politique avec Tel quel d’Ahmed Reda Benchemsi, qui constitue, malgré les libertés qu’il prend parfois avec la déontologie, le fleuron de la nouvelle presse.
Avec le recul des partis et simultanément l’émergence d’une presse dynamique, audacieuse, qui en veut, on assiste à une curieuse inversion des rôles, des perceptions et des attentes de l’opinion. C’est le monde à l’envers. Ce sont les journaux qui font de la politique et les partis qui commentent. Il n’est pas certain que cette substitution des rôles, cette confusion des genres, soit bénéfique pour la démocratie. La presse gagnerait à résister aux tentations politiques et à respecter scrupuleusement les exigences d’un métier qui consiste d’abord - on l’oublie trop souvent ici - à rechercher la vérité et à la dire modestement.
Mais les incursions de la presse hors de ses frontières ne font que souligner l’impéritie des partis. Les velléités « impérialistes » des journaux n’auront peut-être qu’un temps, mais on ne voit pas, pour le moment, comment les partis pourront sortir de leur léthargie. Leur carence a de quoi préoccuper tous ceux qui ont à cœur l’avenir de la démocratie dans ce pays. Car, faut-il le rappeler, les partis sont consubstantiels à la démocratie, il n’y a point de démocratie sans partis.
Ce qui n’arrange rien, c’est que les « solutions » répandues dans l’opinion semblent malheureusement relever de la pensée magique. Parce que les partis sont réputés traditionnels, ont fait leur temps, on croit qu’ils vont céder la place à de nouveaux partis. De fait, plusieurs ont vu le jour avec l’intention affichée d’occuper les places vacantes et ils ont disparu comme ils sont nés, du jour au lendemain, et aucun n’a résisté à l’épreuve des urnes.
La faveur dont bénéficie ces derniers temps le Parti de la justice et du développement (PJD) doit également beaucoup à la pensée magique. N’ayant jamais siégé au gouvernement, il est crédité des vertus du changement. À y regarder de plus près, on découvre que la formation islamiste est tout aussi « traditionnelle » que les autres et que le changement qu’elle se propose d’opérer ne va pas nécessairement dans la bonne direction (voir l’interview de Saad Eddine ?el-Othmani, leader du PJD, J.A. n° 2360 du 2 avril 2006).
Après les solutions fausses ou illusoires, voici l’erreur de diagnostic. Selon une opinion très répandue, exprimée de façon diffuse ou déclarée, c’est le fonctionnement de la monarchie, sinon la monarchie elle-même, qui est à l’origine du mal. Les partis sont faibles parce que le système monarchique, hérité de Hassan II, est trop fort. En d’autres termes, c’est la prépondérance du roi et de la « monarchie exécutive » qui a provoqué le déclin des partis et l’anémie de la vie politique. Il suffirait donc de réduire les prérogatives du roi pour réanimer les partis et la scène publique par la même occasion. À cet effet, on évoque régulièrement une révision de la Constitution, mais il n’est pas certain, s’agissant très précisément de la question des partis, qu’elle puisse produire le salut attendu.
À vrai dire, chacun peut constater que le roi comble un vide plutôt qu’il empêche ou inhibe les initiatives. En mobilisant les compétences, il a à cœur d’accélérer les réformes et les grands chantiers qui sont en train de transformer le royaume. Son activisme est sans doute le fruit de son coefficient personnel, mais il s’explique aussi par les carences et les défaillances des autres protagonistes en titre de la vie politique. Le petit peuple ne s’y trompe pas : « Heureusement qu’il y a le roi… »
L’explication est ailleurs. Le mal réside dans le déphasage des partis par rapport aux temps nouveaux. Le Maroc a profondément changé, mais les partis n’ont pas pris toute la mesure du changement. Ils sont traditionnels dans leur tête, et pas parce qu’ils sont anciens. Ils sont dépassés, désorientés, paumés parce que, paradoxalement, ils ont atteint leurs objectifs et n’ont pas su s’en donner de nouveaux. Pendant quarante ans, ils ont affronté Hassan II. C’était la monarchie qui était en cause. Ils avaient leurs idées sur la monarchie, diverses et variées, mais il est clair que leur monarchie assurément plurielle n’était pas celle, unique, de Hassan II. D’une manière ou d’une autre, de l’intérieur du système ou aux marches de la légalité, ils ont combattu pour le pouvoir, pour ne pas dire pour le pouvoir suprême. Mais cette question a été tranchée une fois pour toutes par Hassan II avec, et c’est essentiel, l’assentiment de tous, à commencer par les partis. Désormais, le Maroc vit sous sa monarchie, forte, constitutionnelle, intouchable. Le gouvernement d’alternance a consacré la conclusion, dans la concorde d’un long combat douteux. C’est la fin d’une époque et un happy end.
Dans l’euphorie, on ne s’était pas aperçu que les partis avaient perdu au passage leur raison d’être. Ayant focalisé pendant des lustres toute leur attention et toute leur énergie sur la monarchie. Maintenant que la monarchie est incontestée, ils se sont retrouvés pour ainsi dire en chômage politique. Certes, le pouvoir suprême n’est pas tout ; d’autres pouvoirs situés à des niveaux moins élevés et qui concernent la vie quotidienne des Marocains (éducation, habitat, santé…) sont tout aussi essentiels.
De Hassan II à Mohammed VI, il y a une autre manière de faire de la politique, moins noble, plus modeste, plus terre à terre. La classe politique tarde visiblement à s’en accommoder. Il n’est même pas certain qu’elle puisse y parvenir. Une chose reste sûre : tant que les partis ne se seront pas adaptés au nouveau Maroc, ce qui implique un profond changement des mentalités et des comportements, une véritable mise à niveau politique, ils risquent fort de persévérer dans leur nullité et d’avoir leur avenir derrière eux.
/
Jeuneafrique /